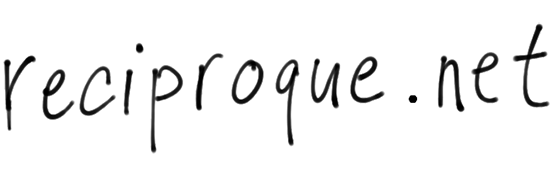Voilà plus de 6 ans que je ne touche plus a mon blog personnel, qui va fêter ses 25 ans d’existence. Je ne sais pas quelle lubie m’a pris ce dimanche après midi ensoleillé de confinement parisien pour mettre à jour le CMS et me voilà parti à relire de veilles archives. La nouvelle version… Poursuivre la lecture Nouvelle vue
La gouvernance éditoriale
Mettre en place une stratégie numérique pour un musée impose d’être au clair sur la stratégie éditoriale des produits et des services proposés par l’institution. Pour simplifier il y a quatre composants complémentaires : l’essence (le contenu), la structure (les canaux de mise en forme), les circuits de production (workflow), la gouvernance (la meta-organisation). L’essence,… Poursuivre la lecture La gouvernance éditoriale
10 recommandations pour le développement et la maîtrise de dispositifs numériques dans les musées
Sur les 8 dernières années, reciproque a conseillé, conçu, développé, géré 60 projets numériques pour plus de 30 clients. Ces projets ont connu diverses histoires et dimensions, différents impacts sur les visiteurs, mais ils ont permis un progrès sensible dans la conduite de projets au sein de l’agence. Peu a peu, nous avons défini quelques… Poursuivre la lecture 10 recommandations pour le développement et la maîtrise de dispositifs numériques dans les musées
Transition (numérique)
Par transition on désigne aujourd’hui une phase très particulière de l’évolution d’une société, où celle-ci rencontre de plus en plus de difficultés, internes et/ou externes, à reproduire le système économique et social sur lequel elle se fonde et commence à se réorganiser, plus ou moins vite ou plus ou moins violemment, sur la base d’un… Poursuivre la lecture Transition (numérique)
The making of exhibitions
Dans un rapport qui date de 2002, le département Office for Policy and Analysis de la Smithsonian Institution s’intéresse à la place des créations d’exposition dans les structures des musées et étudie la façon dont les expositions se créent dans les musées, leurs groupes de travail, leurs équipes, leurs processus… Toujours d’actualité, le rapport souligne… Poursuivre la lecture The making of exhibitions
Assez de mystifications
Nous considérons le spectateur comme un être capable de réagir. Capable de réagir avec ses facultés normales de perception. Voilà notre voie. Nous proposons de l’engager dans une action qui déclenche ses qualités positives dans un climat de communication et d’interaction. Notre labyrinthe n’est qu’une première expérience délibérément dirigée vers l’élimination de la distance qu’il… Poursuivre la lecture Assez de mystifications
Nouveaux outils (v3)
Parce qu’il faut bien actualiser un post obscur de ce blog paru en aout 2007, j’ai décidé de repréciser ici les outils logiciels utilisés par reciproque pour son activité. En fait, fort peu de choses ont changé en 5 ans. Les machines (nous avons migrés sur Macbook en 2011) ont évoluées plus vite que les… Poursuivre la lecture Nouveaux outils (v3)
Musée-o-mix
L’hackathon muséal de l’année, où des équipes bénévoles proposent de nouvelles expériences de médiation en seulement 3 jours, Museomix 2012 se déroulait au musée Gallo-Romain de Lyon du 19 au 21 octobre. Encadrés et coachés par des professionnels, une centaine de participants inventent et développent 10 prototypes, testés ensuite par des visiteurs-utilisateurs pendant deux semaines.… Poursuivre la lecture Musée-o-mix
L’empire de l’illusion
Selon Chris Hedges, le culte de l’illusion de nos sociétés occidentales annonce la mort de la culture et le triomphe du spectacle. D’après son